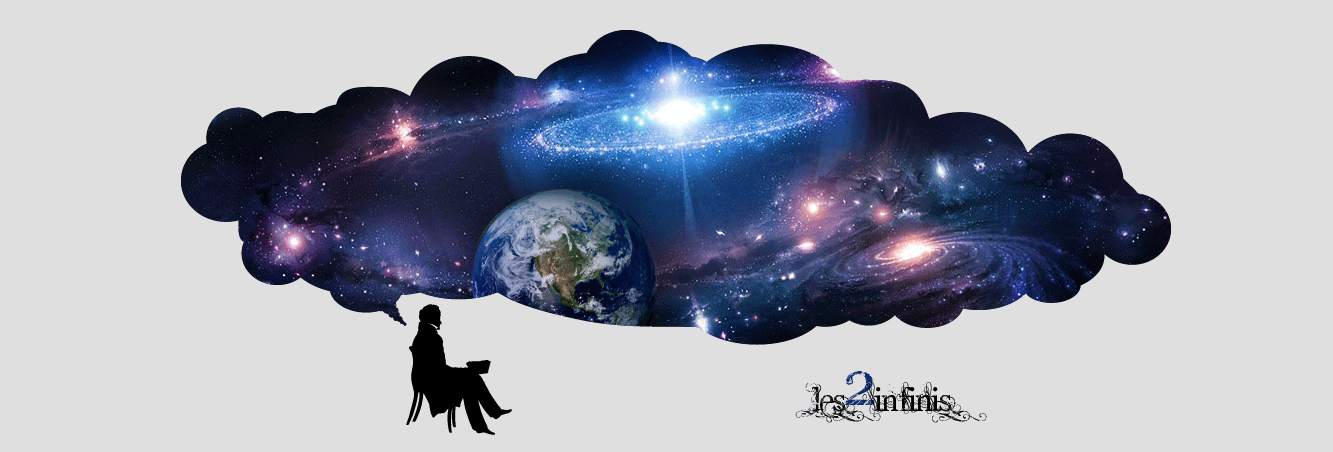Le corps comme image mentale
Entretien avec le Dr Roger Godel médecin cardiologue, philosophe et spiritualiste français décédé en 1961
Extrait de L’homme et la connaissance, édition Le courrier du livre 1965
A. — Avant ton départ je souhaiterais t’engager à développer encore une fois ce que tu entends par : le corps est une image mentale, et, deuxièmement, les conséquences que cette donnée implique.
Le Docteur. — Que le corps soit une image mentale, c’est une évidence que nous avons à tout instant, et que, pourtant, nous manquons de réaliser, nous manquons de reconnaître, pourquoi ? parce que, de notre corps, nous avons une expérience par le toucher, une expérience par la vue, une expérience par la douleur que nous lui attribuons — les douleurs dont nous prétendons du moins qu’il est l’origine —, et il est pour nous une constante sollicitation, de telle sorte que cet ensemble — cette imagerie, pouvons-nous dire, cette construction de l’esprit — nous revêt comme s’il était attaché à nous par des liens indissolubles.
A. — Qu’est-ce que tu entends par là ? Que cette image ne repose sur absolument rien de physique ?
Le Docteur. — Ce que nous appelons physique est une idée, un concept. Nous faisons du physique ou du moral une idée purement mentale, uniquement mentale. Nous disons : ceci est physique, ceci est moral. C’est une façon de définir les choses, c’est une façon de définir un phénomène. Cette définition, elle, n’est donc que mentale, elle s’applique à des choses que nous avons le tort d’appeler des réalités ; mais là encore, quand nous attribuons la réalité à l’état physique, matériel, c’est une affirmation d’expérience, une affirmation purement empirique, et discutable, contestable, qui n’appartient qu’à nous. Non ?
A. — Oui… Mais il m’est difficile de comprendre que si j’ai une douleur, je l’ai inventée…
Le Docteur. — Ah mais je n’ai jamais dit qu’une douleur était inventée, je n’ai jamais dit que le corps était inventé. Il donne lieu à des effets manifestés dans un champ de conscience qui est le nôtre, mais si tu sépares cette imagerie ou cet ensemble de représentations du champ de conscience dont tu es toi-même la projection, que reste-t-il ? Un corps qui ne serait pas construit sur un modèle de ta représentation, que serait-il ?
A. — Il ne serait rien, ni moi non plus…
Le Docteur. — Mais non, il ne serait rien, ni toi non plus, c’est exactement cela. S’il n’est rien, toi, telle que tu te considères telle que tu prends conscience de toi-même, tu cesses aussi d’avoir un sens. Donc, l’imagerie et l’idée que tu te fais de toi-même sont solidaires — une seule et même chose…
J’ai un corps, si ce corps disparaît, je ne suis rien, c’est bien une identification avec le corps. Or, ce corps est-il autre chose que l’ensemble des constatations que tu peux faire ?..
A. — Il est mon moyen de communication avec le monde extérieur.
Le Docteur. — Il n’est jamais qu’un moyen de communication avec toi-même.
A. — …et avec le monde extérieur.
Le Docteur — …avec le monde que tu appelles extérieur.
A. — …et qui est ?
Le Docteur. — …qui est, mais qui n’est pas extérieur — qui est extérieur à cette imagerie du corps. Mais est-il extérieur à toi-même ce monde ? Puisqu’il se présente à toi, comment peut-il être extérieur à toi ? Il est extérieur à ton corps, pas à toi. Il est hors de ton corps, c’est incontestable, cette table n’est pas dans ton corps, Marguerite n’est pas dans ton corps, elle est distincte de ton corps, mais est-elle hors de ton champ de conscience ? Hors de ta conscience ? Si elle était hors de ta conscience, tu ne pourrais pas l’atteindre ni par des paroles, ni même par le sentiment d’une présence. Dès qu’un corps ou une chose pénètrent dans ton champ de conscience, cela en fait partie intégrante. Rien n’est hors de ta conscience qui soit concevable, représentable ou imaginable.
A. — …et en mon absence ?
Le Docteur. — Tu postules des présences en ton absence, tu dis : ah je m’en vais et je laisse des gens à tel endroit. C’est une idée que tu te fais, c’est aussi une représentation que tu te donnes. Tu imagines des personnes, tu les situes, par tes souvenirs, tu les situes par ton évocation de leurs silhouettes, de leurs formes et de leurs occupations, tu les situes quelque part dans un cadre qui t’est familier, c’est encore quelque chose que tu évoques.
A. — Mais tu es aussi témoin de mes propres évocations…
Le Docteur. — Je suis témoin seulement de ce que j’affirme, de ce que je déclare. Je ne peux pas être témoin en ton lieu et place, je ne peux pas être témoin pour toi, tu récuserais mon témoignage. Comment puis-je me situer là où tu te situes toi-même ? Comment puis-je te voir telle que tu te vois ?
A. — Nous sommes cependant deux à témoigner des mêmes objets.
Le Docteur. — Mais non, nous nous mettons d’accord pour donner un même nom à des objets, ou pour les décrire de façon similaire. En fait, nous ne pourrons jamais confronter nos expériences ; elles nous sont intérieures, elles ne peuvent pas être confrontées. Il faudrait que je sois simultanément toi et moi pour pouvoir dire : ah, ce que Alice voit bleu, moi je le vois bleu, comment puis-je me situer là où tu te situes, avoir le même spectacle sans être toi-même ? Si cela était possible, c’est que je suis toi, je suis réellement toi, et la vision que tu as, sera la mienne. Si j’aime le bleu et que tu n’aimes pas le bleu, il est certain que tu ne vois pas la couleur de la même façon que moi, parce qu’elle n’est pas simplement une sensation, elle est aussi une adhésion ou un refus. Elle ne peut pas être exactement semblable…
A. — Et cependant quelque chose la rend possiblement compréhensible à toi et à moi…
Le Docteur. — Ce quelque chose résulte uniquement de notre accord, c’est-à-dire d’une convention entre nous. Cette chaise porte une couleur bleue, elle est de couleur bleue, et tu acquiesces, parce que chaque fois que tu as signalé sur un objet la couleur bleue, j’ai pris conscience d’une couleur qui, pour moi, était ce qu’elle est et qui correspondait à ton bleu.
A. — Oui, mais il y a un phénomène qu’il soit ou ne soit pas bleu, et qui est interprété bleu, et un phénomène qui me fait dire bleu et qui te fait dire bleu, d’accord.
Le Docteur. — Et alors? Qu’est-ce que prouve ce phénomène ?
A. — …indépendant de moi personnellement, puisque tu es devant moi, témoin de ce phénomène, et que tu le traduis comme moi — par accord, d’accord…
Le Docteur. — Un accord verbal, et d’ailleurs purement verbal. Cet accord témoigne simplement d’une constance dans les affirmations, c’est tout. Elles ne prouvent rien de plus, elles ne prouvent pas que le bleu soit bleu. Elles prouvent que nous sommes d’accord pour donner le nom et la qualité de bleu à telle expérience empirique, et que par conséquent une similitude dans les constitutions se révèle.
A. — Mais elle est humaine, non ?
Le Docteur. — Qu’est-ce que c’est que l’humain ?
A. — …elle est propre à l’humain cette expérience… il y a donc…
Le Docteur. — …encore un mot, encore un concept, l’humain. L’humain, qu’est-ce que c’est l’humain ?
A. — Je reviens donc maintenant à ma seconde question : Quelles sont les conséquences que cette donnée implique ? Puisque je construis mon image et mon monde, puis-je en transformer le destin ? Et puis-je me reforger différente de ce que je suis ?
Le Docteur. — Eh bien, la question : « puis-je ? ». Que représente ce je dans le « puis-je » ? Cela représente un niveau de perception, cela représente une instance dans un monde illimité de possibles. Je me conçois comme tel, comme un être fini, un être arrêté dans sa forme, dans ses contours, dans ses possibilités. Eh bien, à ce titre-là, évidemment je suis totalement impuissant. Je dois admettre au préalable la possibilité d’un renouvellement complet, total et incessant de moi-même. Donc ce qui va bénéficier de la transformation, ce n’est pas moi, c’est un devenir incessant qui bénéficiera de la transformation. Et ce devenir, où doit-il aboutir en fin de compte ? A un dépouillement complet, total de toutes les cristallisations que ma pensée peut retenir pour me limiter.
Tu vois ce que je veux dire ?
Nous ne sommes pas ce que nous paraissons être à nos propres yeux. Nous ne sommes pas cela. Nous sommes ce perpétuel devenir, cette perpétuelle transformation qui, en nous anéantissant, nous renouvelle. Elle ne peut nous renouveler que par un continuel anéantissement des formes auxquelles nous nous attachons, auxquelles, momentanément, nous nous identifions.
Alors, qui est le bénéficiaire de la transformation Non pas moi qui suis en train d’énoncer l’espoir d’une transformation, mais un être dont, présentement, je ne sais rien.
Que serai-je en fin de compte, si je bénéficie de ce à quoi, j’aspire ? Que serai-je ?
Je serai ce que je suis réellement. Non pas ce que je parais en ce moment.
A. — Ce que je suis réellement est inamovible… il n’a rien à gagner ni rien à perdre ?..
Le Docteur. — Non. Mais cette conscience au niveau de laquelle je vis peut bénéficier d’un éclaircissement. De noire elle peut devenir lumineuse. Si je vis dans le noir, si je vis dans les ténèbres, si je vis dans la détresse, si je vis dans le scepticisme et dans le désespoir, n’est-il pas bénéfique d’être délivré de cette couleur ?
A. — Mais qui bénéficie, puisque je ne suis qu’une forme, donc créatrice de formes. Par conséquent la forme ne bénéficie de rien, puisqu’elle s’en va…
Le Docteur. — Ah mais la forme ne peut jamais bénéficier de rien puisqu’elle s’en va, comme tu le dis, elle part, elle disparaît, elle glisse dans ce néant que toutes les formes rejoignent ; mais, le bénéficiaire c’est, à tout instant, celui qui est en progrès sur la, situation passée, c’est cet être naissant qui peut être continuellement le bénéficiaire. Si demain je suis plus heureux que je ne l’étais aujourd’hui, que puis-je dire du bénéficiaire ? Que c’est un autre que l’être malheureux qui subissait le malheur la veille ; un autre. Celui qui est malheureux ne sera jamais heureux… il cesse d’être malheureux par le fait même.
A. — Cet être que j’appellerai ici : intermédiaire, et qui n’est ni l’être réel, inamovible, que rien ne change et que rien ne déçoit, ni la forme qui s’en va, serait une espèce de liaison… n’est-ce pas ?
Le Docteur. — Bien sûr, ce ne sera jamais que cette… on pourrait dire que cette forme ou ces formes de transition qui pourront être en progrès les unes par rapport aux autres et être bénéficiaires les unes comparativement aux autres…
A. — Alors comment peuvent-elles se changer, se transformer, s’éclairer, s’ensoleiller ?
Le Docteur. — Oui. Eh bien, dès lors, qu’elles s’informent des lois auxquelles elles sont soumises, qu’elles connaissent les lois qui font évoluer leur condition de formes. Si, par exemple, dans cet être auquel momentanément je m’identifie, cet être physique, psychique, mental, sensible, etc., si cet être puise, en la conscience, aux normes pour en connaître la structure, pour en connaître le fonctionnement, que découvrira-t-il ? Il découvre que loin d’être une individualité séparée du reste de l’univers, il est immergé dans une sorte d’océan, océan que l’on pourrait provisoirement comparer à un vaste champ de conscience. Il est inséparable de ce champ. Il n’y a pas de cloison étanche là où disparaît le confin, la limite stricte d’un corps. Entre deux corps il peut n’y avoir aucun contact, il peut y avoir un intervalle d’espace, mais entre deux champs de conscience il n’y a pas de frontière ; il n’y a d’autre frontière que la distance qui oppose les attitudes, mais il n’y a pas de frontière spatiale entre des champs de conscience. Par conséquent, l’idée même de séparation — de séparation spatiale — ne peut être appliquée à la notion de champ, pas plus qu’à l’intérieur d’un champ magnétique il n’y a de trous et de déchirures qui sépareraient les particules de ce champ ou les lignes de force constituant ce champ. Le champ est une continuité, non pas une continuité dans l’espace, mais une continuité substantielle, une sorte de consubstantialité. Cette substantialité est faite de conscience, par nature. De sorte que nous plongeons dans cet océan, et tout ce qui nous porte à une attitude, emprunte à la totalité du champ ses complicités. Complicité pour la déchéance, complicité pour la destruction, ou complicité pour une avance sur un terrain nouveau, pour un renouvellement. Et sans que nous nous en doutions le moins du monde, chacune de nos attitudes se trouve spontanément assistée par tout ce qui lui est conforme, tout ce qui lui est de nature semblable. Nous aspirons vers un plus grand bien, le bien épars dans ce champ cosmique universel afflue vers nous et nous porte et renforce nos aspirations. Si nous aspirons à un acte mauvais, cet acte mauvais est cent mille fois renforcé par tout le mal qui règne dans le champ. Un acte de violence reçoit la complicité de toutes les violences éparses.
A. — Est-ce que la même donnée peut s’appliquer aux lois physiques ? Par exemple : j’ai une douleur, je la vois avec désespoir, elle s’aggrave, elle aspire tout ce qu’il y a de douloureux autour de moi, et vice versa ; si au contraire je suis confiante, la chose par elle-même peut se transformer par le fait que… ?
Le Docteur. — Oui. Eh bien, là nous arrivons au phénomène de matérialisation. Dans la mesure même où nous matérialisons une attitude, une sensation, un état de conscience, la densité, le durcissement en quelque sorte de cet état se constitue. Par exemple, si je souffre et si je localise ma souffrance, si je lui donne une base matérielle et physique, la voici comme ancrée en moi. C’est comme si cette souffrance avait trouvé son terrain d’atterrissage et permettait l’atterrissage d’une multitude d’autres éléments de souffrance. Alors, puisque précisément nous nous donnons un corps physique et que nous attribuons à ce corps physique l’origine de toutes nos souffrances, nous les matérialisons par là même. La souffrance, tout en étant psychique — elle est sentie comme un élément, je dirais, de notre conscience de vivre. Néanmoins elle participe à la matérialité des choses, c’est-à-dire à leur dureté, à leur durée, à leur inéluctable imposition. Ce qui est matériel, c’est quelque chose que l’on ne peut pas éviter : si je me heurte à une table, si je vais vers une table, je me cogne contre cette table, pourquoi ? Parce qu’elle a revêtu le caractère matériel et cette matérialité est quelque chose qui résiste à la pénétration. Le caractère même de la matière c’est d’être impénétrable et de se présenter comme chose impénétrable. Dès que nos états de conscience prennent affinité avec ce qui est matériel et s’établissent sur des bases — et en particulier sur des bases d’interprétation matérielle —, elles s’imposent à nous d’une façon indéracinable. C’est pour cela qu’il est tellement dangereux de donner à des malades l’explication matérielle de leur douleur : « Vous avez mal à cause de ceci, vous avez mal parce qu’un nerf est comprimé dans votre dos ». Eh bien, le malade a matérialisé sa douleur, il lui a trouvé — à tort ou à raison — une cause mécanique, une cause à laquelle on ne peut porter remède qu’en détruisant la matière, alors il faut couper à partir de ce moment-là ; il faut couper ou déconnecter les contacts, du nerf par exemple, avec la masse qui le blesse, avec un os qui le blesse, ou avec un disque de cartilage qui le blesse. Parce qu’on lui a donné force matérielle, consistance matérielle, et irréductibilité matérielle. Si, par contre, on fait découvrir au malade la signification fonctionnelle de sa douleur, l’origine fonctionnelle de la douleur et non matérielle — comme ce qui est fonctionnel n’a pas consistance —, on peut par une opération purement fonctionnelle, c’est-à-dire dynamique, le délivrer également. De même, lorsqu’on donne à un malade une conception organique de son état morbide : on lui explique que son cœur est atteint de tel et tel défaut organique, et que c’est là que se trouve l’origine de toutes ses perturbations, il est évident qu’aucun remède ne peut lui être apporté sans qu’une transformation matérielle soit possible. Or, il n’y a guère de transformations matérielles qui soient opérantes, opérantes d’une façon définitive parce que, en somme, la vie est fonctionnelle, elle n’est pas matérielle, elle est fonctionnelle, elle est perpétuelle émergence de transformation et de renouveau. Alors, elle recrée constamment, elle n’immobilise rien, rien n’est jamais immobilisé dans la vie. Tout est perpétuellement remis en question, aussi bien sur le plan de la substance physique la plus matérielle que sur le plan des créations mentales.
Alors j’en reviens à ceci : rendre organique l’interprétation des maladies c’est condamner les gens à une fixation, à un ancrage dans la destructibilité de la matière.
A. — Alors des guérisons peuvent s’opérer, des guérisons de matière — de ce que nous appelons matière — par une vision…
Le Docteur. — Elles le pourraient, oui, par une vision correcte. Elles le pourraient. Seulement, l’empêchement à cette solution provient de ce qu’il est pratiquement impossible de convaincre un homme de l’immatérialité de ce qui se présente à lui comme matériel. Lui faire admettre que ce corps qui résiste à la main, qu’il peut frapper et traumatiser et blesser, soit une pure imagerie, une création de l’esprit, et que cette création revête le caractère du concept matériel, cela lui est inaccessible. Alors, il retombera toujours dans la matérialité de son identification avec le corps. Lui demander d’accepter que son organe — par exemple le cœur ou l’estomac — soit une représentation des choses, ne soit qu’imagerie, cela lui est impossible. Mais s’il le pouvait, il guérirait, évidemment, il guérirait parce qu’il cesserait immédiatement de procéder à cette matérialisation de l’image qui est la cause, qui est l’origine de toutes les identifications avec de la matière. Si je m’identifiais avec tous mes globules rouges et si j’étais convaincu que mon sort est lié au sort de ces globules rouges, je mourrais dans les trois mois parce que pas un seul de ces globules rouges ne subsistera. Donc je périrais, je mourrais, bien que d’autres globules rouges soient venus renouveler la masse sanguine. Alors il est extrêmement difficile pour un homme de retirer sa conviction de cette identité avec la matière du corps. Le corps est matière, c’est une chose presque indéracinable. C’est une des plus grosses résistances que l’on rencontre dans l’éducation individuelle.
A. — Alors, là il y a un problème qui est extrêmement grave, c’est la croyance du malade en sa matérialité et du médecin en la matérialité…
Le Docteur. — Bien sûr, c’est la croyance la plus grave qui soit ; non seulement elle est grave, mais elle est persistante. Elle persistera parce que le malade revendique la matérialité de sa maladie comme une sorte de compensation. Il veut être disculpé de toute origine, de toute participation au mal : le mal est quelque chose qui l’a assailli, quelque chose qui le blesse, qui l’attaque, qui le menace. Par conséquent, il lui faut considérer le mal comme une chose extérieure, et même ce corps victime du mal lui est extérieur, et il demande que le mal lui soit retiré. Il lui faut matérialiser le mal pour, en quelque sorte, le rendre objectif. Il ne peut pas le considérer comme fonction inhérente de sa vie parce qu’alors ce serait trop intimement attaché à lui… Mais en le matérialisant dans le corps, il dit : « Mon cœur est malade, mon cœur menace ma vie, je ne suis donc plus mon cœur, je m’en dégage, je m’en désolidarise. Je vous remets ce cœur, soignez-le, remettez-le en état comme je vous remettrais ma voiture pour qu’on la confie au mécanicien, au réparateur. Réparez cela ». Et c’est là qu’est véritablement la tâche, je dirais ingrate, du médecin :
c’est que des organes matériels qui lui sont confiés par le malade pour être rétablis dans leur intégrité, alors que le malade les a lui-même matérialisés — avec la complicité du médecin, d’ailleurs —, les a lui-même matérialisés pour les rendre en quelque sorte indépendants de lui : « Je suis malade, pauvre corps malade, prenez-en soin, remettez-le d’aplomb. Je n’ai aucun contact avec ce corps, je n’ai aucun pouvoir sur ce corps… »
Tu comprends cela ? « Je vous le remets, je vous le confie, faites-en ce qu’il faut. Endormez-moi et opérez-moi et j’ignore tout ce que vous voulez faire, ce n’est plus mon affaire… »
Le corps est confié comme un objet à son réparateur. Alors l’individu s’en désolidarise, et pourtant — et voilà la fausse position — et pourtant il continue de s’identifier avec ce corps. Si on touche ce corps il pousse des cris, comme si…
A. — Cela me rappelle ce que le grand cardiologue disait : qu’on opérait certains malades — c’est-à-dire qu’on ouvrait sans opérer, et qu’en refermant, le malade se croyait guéri.
Le Docteur. — C’est très courant, pour toutes les opérations…
A. — …il suffit d’y croire…
Le Docteur. — …qu’il ait la conviction que le nécessaire lui a été appliqué et…
A. — C’est extraordinaire !..
Eh bien je crois qu’en relisant ceci ou en ré-écoutant ce que tu as dit — ce que tu viens d’enseigner, qui m’a été enseigné depuis tant d’années, je peux te rassurer, au moment de ton départ que je ne serai pas malade.
Le Docteur. — …Je souhaite que non seulement tu ne sois pas malade, mais que tu sois en plein soleil, en pleine lumière, tu l’es, tu es la lumière…
La Jonchère, le 14 mai 1960.
Source : revue3emillenaire